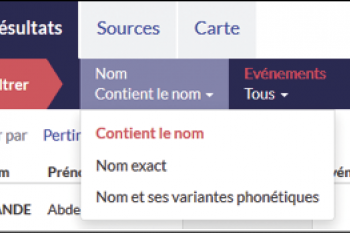Léger
Les imprécisions qui règnent sur les patronymes issus de vieux surnoms germaniques laissent toujours planer une large part de mystère sur leur véritable origine. Cette énigme est d’autant plus grande que nous sommes en présence de dénominations qui nous font remonter quinze siècles en arrière. Souvenons-nous de la chute de l’Empire Romain, au milieu du Premier millénaire. À cette époque, les chefs de guerre germaniques portaient des noms particuliers. Par exemple, Leud-gari (composé des racines leud, peuple et gari, lance). Ce surnom originel avait donc un sens symbolique qui s’est perdu au fil du temps quand il fut adopté par les familles gallo-romaines. La christianisation aidant, la forme latine Leudgarius est devenu un nom de baptême. À partir du XIIIe
siècle, ce nom de baptême s’est transformé à son tour en patronyme héréditaire, c’est-à-dire transmis par le père de génération en génération, sous la forme Leudgar puis sous la forme Léger. Saint Léger, évêque d’Autun, gouverneur du palais du roi Clotaire, VIIe siècle : son culte s’est répandu dans toute la France, si bien qu’on compte 55 communes qui portent le nom de Saint-Léger de nos jours. Avec 6 625 foyers, soit environ 18 000 personnes, le patronyme Léger occupe le 141e rang des noms les plus fréquents en France. Sa répartition géographique le situe principalement en Normandie, dans le Centre et en Limousin. De toute évidence, le patronyme Léger doit être considéré comme polyphylétique : du grec poly, « plusieurs » et phylum, « race », « tribu ». Cette notion s’est appliquée en généalogie à un nom de famille qui s’est développé au travers des siècles à partir de plusieurs souches distinctes. C’est le cas de la majeure partie des patronymes qui comptent plus de 300/500 foyers en France de nos jours. Formes patronymiques proches : Légier (Bouches-du-Rhône), Ligier (Doubs, Meuse) ; Légerot (Est), Légeret (Centre), Légeron (Poitou), etc.