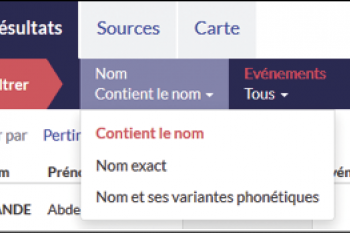Chapus
L’origine de ce nom de famille pourrait remonter au début du XIVe siècle : en 1313, on relève plus de trois cent cinquante professions différentes dans le précieux « Livre des Mestiers » dressé sur ordre d’Étienne Boileau, prévôt du Roy. Il nous fait connaître de nombreux détails sur le travail de la foule d’artisans et de commerçants qui peuplait campagnes, bourgs et cités. Comment le nom de famille Chapus est-il né ? Entre le Ve et le XIIIe siècle chacun des habitants de notre pays portait un nom unique, son nom de baptême. À partir du XIIIe siècle, pour différencier les homonymes devenus trop nombreux, on a pu surnommer « Chapus », « l’homme qui exerçait un métier du bois », de l’ancien français chapuiser, « tailler », « charpenter » et de chapuis, « armature en bois des bâts et des selles », mais aussi « billot », comme dans : « Jehan couppa le pain sur le chappuiz… » (XVIe siècle). À partir du XVe siècle, le surnom « Chapus », devenu usuel, a pu être consigné sur les anciennes chartes et les registres des terriers (cadastre), puis au XVIe siècle, c’est au hasard d’un acte de baptême, de mariage ou de sépulture qu’il est devenu un nom de famille héréditaire. Fréquence et localisation : le patronyme Chapus compte 630 foyers en France de nos jours. Il se montrait déjà bien présent en Ardèche, dans le Gard, la Drôme, les Bouches-du-Rhône à la fin du XIXe siècle, départements auxquels il faut ajouter les Bouches-du-Rhône et l’ensemble de la région Ile-de-France à la fin du XXe siècle. À signaler une quarantaine de lieux-dits « Chapus », essentiellement dans le centre, l’ouest et le sud de la France, ils signalent la présence ancienne de familles de ce nom en ces lieux. Pour mémoire : avec 3 480 foyers, soit environ 9 000 personnes, le patronyme Chapuis, de même origine étymologique, occupe le 360e rang des noms les plus fréquents en France. Sa répartition géographique le situe principalement dans le Sud-Est.