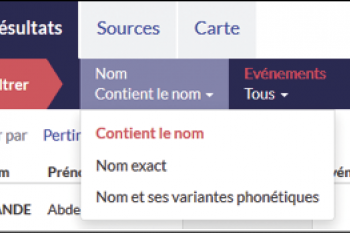Le Guen
Ce nom de famille est issu d’un nom de baptême. À la fin de l’Empire romain, la christianisation a remplacé très progressivement les noms romains anciens par ce genre de nom de baptême. Sa fréquence s’explique aussi bien par le prestige d’un saint homme que par sa position hiérarchique. Comment est-il devenu héréditaire ? Entre le Ve et le Xe
siècle chacun des habitants de notre pays ne portait que son nom de baptême. À partir du XIIIe siècle, pour différencier les individus, est apparu le nom de baptême Guen, Le Guen, du breton gwen, « blanc », « pur », « sans tache ». Il a fait l’objet de très variantes, notamment en fonction des parlers locaux… Enfin, ce n’est qu’à partir du XVe siècle au hasard, de la transcription sur un acte de baptême, de mariage ou de sépulture que ce nom de baptême est devenu héréditaire, se transformant en nom de famille. Saint Guén ou Guénau, moine breton (VIe siècle) : élevé par saint Guignolé, il gouverne pendant sept ans le monastère de Landevenec, puis fonde des établissements religieux sur l’île de Groix et à Vannes. Fréquence et localisation : le patronyme Le Guen, Leguen compte 3 600 foyers en France de nos jours. Il se montrait déjà bien présent dans le Finistère, les Côtes-d’Armor, le Morbihan à la fin du XIXe siècle, départements auxquels il faut ajouter la Seine-Maritime et l’ensemble de la région Ile-de-France à la fin du XXe
siècle. Formes patronymiques proches : Guennec, Le Guennec, Guene, Le Guenne, etc. De toute évidence, le patronyme Le Guen doit être considéré comme largement polyphylétique : du grec poly, « plusieurs » et phylum, « race », « tribu ». Cette notion s’est appliquée en généalogie à un nom de famille qui s’est développé au travers des siècles à partir de plusieurs souches distinctes. C’est le cas de la majeure partie des patronymes qui comptent plus de 300/500 foyers en France de nos jours.