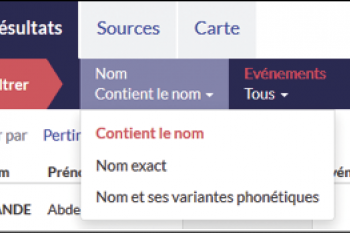Morin
Le surnom donné à l’homme qui avait la peau brune (comme un More ou Maure) explique l’origine de ce nom de famille. De l’ancien français more, maure, autrefois le nom donné aux habitants d’Afrique du Nord et, par confusion, celui de tous les habitants d’Afrique, voire des Indes, comme dans : « Il se mit sur ses vieux jours à aimer une more, qu’il aima et tint en ses délices, de telle sorte qu’il dedaigna toutes sortes de beautez et toutes autres dames honnestes… » (XVe siècle). Autres possibilités : des formes du nom de baptême popularisé par le culte de saint Maur ou More (même origine : « homme brun de peau »), disciple de saint Benoît (VIe siècle) : d’après la tradition, premier des disciples de saint Benoît de Nursie, More est le saint patron des charbonniers, des chaudronniers, des fossoyeurs. Il est fêté le 15 janvier. Quatorze saints et bienheureux portent le nom de Morin, Maur, Maure, ou encore de Maurin. Fréquence et localisation : le patronyme Morin compte 36 000 foyers en France de nos jours. Il se montrait déjà bien présent dans les Côtes-d’Armor, dans les Deux-Sèvres, en Vendée à la fin du XIXe siècle, départements auxquels il faut ajouter le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, l’Ille-et-Vilaine… et l’ensemble de la région Ile-de-France à la fin du XXe siècle. De toute évidence le patronyme Morin doit être considéré comme polyphylétique : du grec poly, « plusieurs » et de phylum, « race », « tribu ». Cette notion s’applique à un nom de famille qui s’est développé au travers des siècles à partir de plusieurs souches distinctes. C’est le cas de la majeure partie des patronymes qui comptent plus de 300/500 foyers en France de nos jours. Les More et les Morin en Europe : Mohr (Allemagne) ; Demoor, Demoore (Belgique et Pays-Bas) ; Moore, Moorehead (Angleterre) ; Maura, Moreno (Espagne) ; Mauri, Del Moro, Morelli, Morini, Morricone… (Italie) ; Maurelês, Maurês (Grèce), etc.