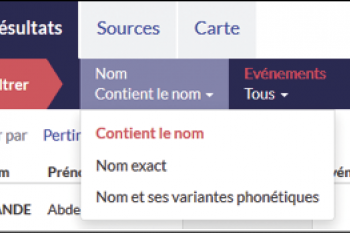Peytour
Nom à rapprocher de Pestour, ancien surnom d’un boulanger, de l’ancien français pesteur et l’occitan pestre (issus du latin pistor), « celui qui pétrit la pâte », mais aussi panetier, « celui qui fabrique le pain » (du latin panis, « galette de farine »). Fort heureusement, ces noms communs n’ont pas disparu, ils ont traversé les siècles grâce à des familles qui avaient probablement oublié depuis longtemps le métier premier de leurs ancêtres… Au XIIIe siècle, le maître boulanger fabriquait et vendait des pains de blé, d’avoine ou de seigle. Il était secondé par un joindre ou geindre (apprenti), des vanneurs ou bluteurs (tamiseurs) et des « compagnons pétrisseurs », prestres ou pistres. Fréquence et localisation : le patronyme Peytour compte 105 foyers en France de nos jours. Il se montrait très présent en Dordogne à la fin du XIXe siècle, département auquel il faut ajouter la Charente, la Gironde, la Haute-Vienne et l’ensemble de la région Ile-de-France à la fin du XXe siècle.
Formes patronymiques proches : Pestre, 300 foyers en France, Haute-Loire, Drôme, Marne ; Peytou, 40 foyers en France, Ariège, Haute-Garonne ; Peytoureau, 110 foyers en France, Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; Peytouret, 15 foyers en France, Dordogne ; Peytout, 25 foyers en France, Gironde, Dordogne ; Peytoud, Peytouraud, Peytouraux, Peytoureaud, Peytoureaux, tous très rares, moins de 10 foyers en France. À signaler les lieux-dits « Grand-Peytour » et « Petit-Peytour » sur la commune de Saint-Saud-Lacoussière en Dordogne. On signale également deux « Peytourie » en Corrèze, un « Peytoureix » dans la Creuse, un « Peytourin » en Gironde et un « Peytouroux » en Isère.